22 octobre 1974: témoignage sur “les graves insuffisances de la loi d’aide sociale”
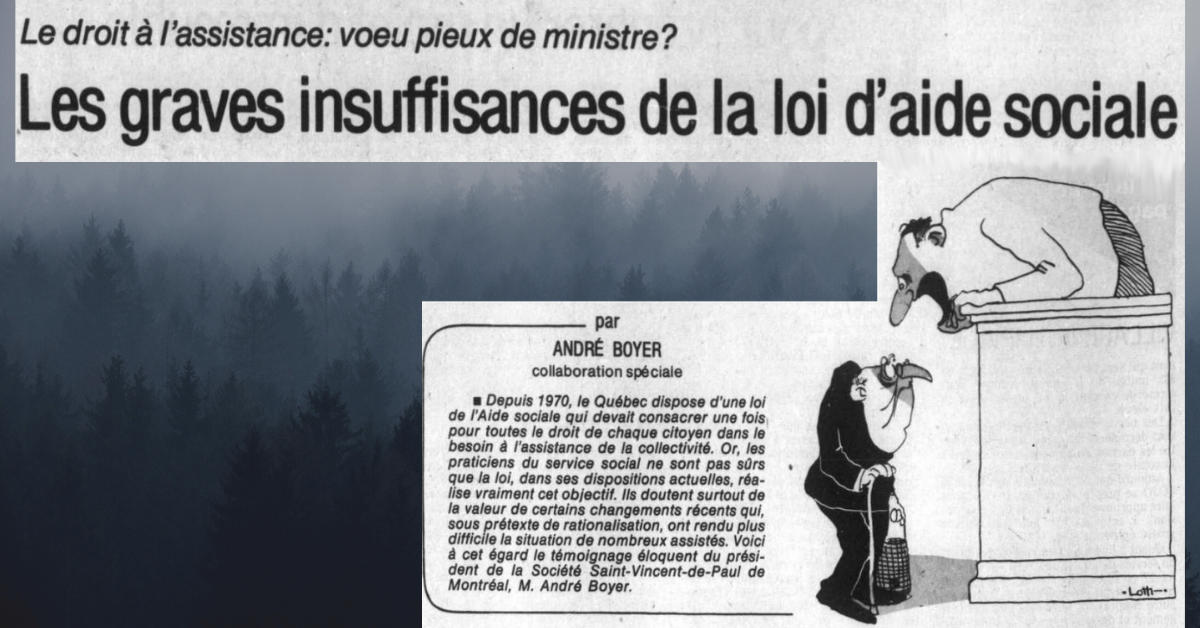
Le Collectif a retracé des archives qui nous ramènent au coeur des débats qui ont précédé ou suivi l’adoption de la Loi de l’aide sociale en décembre 1969.
L’article complet est reproduit ci-dessous (fautes de frappe et d’orthographe comprises).
L’édition complète du Devoir du 22 octobre 1974 se trouve sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Le droit à l’assistance: voeu pieux de ministre?
Les graves insuffisances de la loi d’aide sociale
par ANDRÉ BOYER, collaboration spéciale
Depuis 1970, le Québec dispose d’une loi de l’Aide sociale qui devait consacrer une fois pour toutes le droit de chaque citoyen dans le besoin à l’assistance de la collectivité. Or, les praticiens du service social ne sont pas sûrs que la loi, dans ses dispositions actuelles, réalise vraiment cet objectif. Ils doutent surtout de la valeur de certains changements récents qui, sous prétexte de rationalisation, ont rendu plus difficile la situation de nombreux assistés. Voici à cet égard le témoignage éloquent du président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, M. André Boyer.
Sous le régime français, l’Etat ne se reconnaissait ni l’obligation, ni la compétence d’assumer lui-même la responsabilité de l’enseignement et de l’assistance publique. Ces grandes tâches étaient abandonnées à l’initiative privée, ce qui voulait dire en pratique à la famille et à l’Eglise Catholique. Peut-être l’Etat a-t-il joué un rôle un peu plus actif dans le domaine du bien-être en instituant les bureaux des pauvres, mais on doit tout de suite ajouter que l’activité de ces bureaux était assurée en réalité par le clergé, assisté de quelques laïcs de bonne volonté.
Dans le domaine du bien-être, c’est par les corporations municipales créées à partir de 1832, que l’Etat commencera à se reconnaître une certaine responsabilité à l’endroit des indigents. Pour suppléer en quelque sorte à ce que ne peut faire l’oeuvre privée, la corporation municipale est invitée à s’occuper des pauvres de son territoire ou à aider les institutions de charité. Tout comme pour l’enseignement, c’est ici encore, par la base, c’est-à-dire par la paroisse ou une municipalité, que l’Etat commence à intervenir pour assurer un peu de bien-être à ceux qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Les institutions municipales ne se voient cependant pas formellement obligées d’agir dans le domaine du bien-être; aucune obligation précise et stricte ne leur est faite d’aider les indigents ou les institutions de charité.
Ce n’est qu’avec la loi de l’Assistance publique de 1921, soit il y a un peu plus de 50 ans, que les corporations municipales doivent obligatoirement assumer les responsabilités financières à l’endroit des indigents hospitalisés. Il est donc vrai de dire que c’est très tardivement que l’Etat est intervenu dans le domaine du bien-être et encore ce n’est que pour remplir une fonction supplétive, c’est-à-dire compléter l’action d’un secteur privé déjà actif et efficace.
Cette loi de l’Assistance publique subit quelques modifications mineures entre sa promulgation et 1960. En 59-60, le gouvernement du Québec signait une entente avec le gouvernement du Canada, par laquelle le gouvernement fédéral s’engageait à verser 50% des montants octroyés aux personnes en chômage et dans le besoin (assistance chômage). A la même époque la part des municipalités à ces versements fut abolie. On retrouvait alors une dizaine de formes d’allocations sociales catégorisées (aveugles, invalides, etc.).
Dans le but d’en venir à une politique d’ensemble, le gouvernement Québécois formait en 1961, un comité d’étude sur l’assistance publique. Le rapport (Boucher) fut déposé en 1963. Les recommandations 9, 10 et 11, préconisaient une loi générale d’assistance sociale.
La loi 26
La loi de l’aide sociale fut sanctionnée en décembre 1969. Cette loi était censée être plus humaine et capable de répondre aux besoins des personnes nécessiteuses. Les praticiens des affaires sociales et la clientèle l’attendaient avec impatience, comme le début d’un monde meilleur pour les plus démunis… Déjà cependant l’article 12 laissait transpirer un caractère de statut contrat citoyen travailleur.
En effet on y lit que l’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans une dizaine de situation. Il ne s’agit donc plus de droit à l’assistance, mais de conditions à remplir et à respecter pour y être admissible.
La valeur “travail” y apparaît nettement et laisse place à l’arbitraire dans l’application par les fonctionnaires vis-à-vis certaines normes de la loi. Il n’était pas rare que l’un accepte de verser une prestation, alors que l’autre la refuse, et cela sans autre motif que l’interprétation personnelle de telle ou telle norme par chaque fonctionnaire.
Depuis sa sanction, la loi de l’aide sociale fut l’objet de divers amendements. Un premier amendement fut apporté en novembre 1972: il enlevait le supplément possible pour diètes hyper-protéiniques. En effet dans la loi initiale, ce poste était prévu avec un supplément possible de $10.00 par mois par personne. Or devant des taux d’assistance dérisoirement bas, les praticiens du service social et les avocats populaires encourageaient les assistés à se procurer des certificats médicaux, justifiant ce supplément alimentaire. Le ministère des Affaires sociales se posa en juge médical et ne conserva que quatre cas de types de maladie, où les prestataires de l’aide sociale pourraient bénéficier d’un supplément pour diète spéciale. A cette occasion, un mémoire de la Corporation des Travailleurs sociaux dénonça la loi d’aide sociale “comme étant une loi inhumaine qui ne sert qu’à maintenir les gens dans un état d’indigence inacceptable pour une province civilisée”. Le conseil des affaires sociales, saisi de la question, a reconnu que ces modifications pouvaient comporter de graves et urgents problèmes pour les personnes concernées (rapport annuel
1972-73).
En avril 1973 un nouvel arrêté en conseil vient supprimer les besoins spéciaux dans la loi. Désormais il n’est plus possible à une personne bénéficiant de l’aide sociale de toucher des montants pour la réparation, l’entretien, le remplacement de mobilier, literie, etc… sauf dans quelques cas bien spéciaux (incendie…). L’idée de prévoyance comme philosophie sous-jacente peut sans doute s’avérer valable; encore faut-il que les montants octroyés soient décents et convenables. Or, ils ne l’étaient pas et les suppléments consentis pour combler leur insuffisance furent de l’ordre de $4.00 par mois pour personnes seules et $8.00 par mois pour les familles! En examinant la montée en flèche du coût de la vie, il est bien évident que ces minces suppléments ne peuvent être économisés en vue des fins visées. Ils servent à des besoins primaires comme la nourriture, le vêtement, etc. Que font alors les bénéficiaires de la loi de l’aide sociale lorsque vient le moment de réparer ou remplacer un article de mobilier? Ils n’ont pour tout recours que l’endettement, l’achat d’articles usagés ou le recours aux oeuvres de charité.
Vers la même période (printemps 1973), le ministère des Affaires sociales établissait une liste de médicaments autorisés pour les assistés sociaux. La ’’liste” énumère quelque 3000 médicaments que les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent se procurer gratuitement sur prescription médicale. Si le médecin s’éloigne de la liste, l’assisté social doit se priver du maigre essentiel prévu par son budget et payer lui-même le médicament. Si cette loi d’aide sociale est fondée en principe sur le droit à l’assistance pour satisfaire des besoins essentiels pourquoi une liste limitée de médicaments? L’explication voulant qu’on ait cherché à protéger un groupe de personnes (assistés sociaux) contre l’emploi de médicaments peu valables est fausse. En effet, pourquoi laisser ces mêmes médicaments à la portée de la population en général, s’ils ne sont pas convenables pour une partie de celle-ci? Si des médicaments sont de trop, si les prix sont frauduleux et trop élevés, c’est une protection de tous les citoyens que l’Etat doit imposer. Evidemment ici comme dans plusieurs autres secteurs de la politique sociale, le Québec peut difficilement intervenir puisque plusieurs produits pharmaceutiques ont des brevets du gouvernement fédéral et que la loi du contrôle des aliments et drogues, dans laquelle entre le contrôle des médicaments, est fédérale. L’impact psychologique que crée le traumatisme de se voir enlever les médicaments habituels, (pilules roses remplacées par des jaunes, etc.) a amené des réactions même physiques et le retour à l’ancien médicament ou alors son abandon pur et simple. Il vaudrait mieux ici une législation protégeant le consommateur en général plutôt qu’une mesure discriminatoire à l’endroit des bénéficiaires de l’aide sociale.
Les nouvelles allocations familiales (1974)
Enfin dernière modification, en janvier 1974, en rapport avec les nouveaux barèmes d’allocations familiales. La loi originale permettait un taux de loyer variant de $45.00 à $95.09 auquel pouvait s’ajouter, en certaines circonstances, une majoration jusqu’à concurrence de 50% à titre de besoin spécial. Or par une manigance habile l’on a établi cette échelle à un maximum de $105.00 par mois, précisant bien que ce montant qui doit inclure tous frais inhérents à l’habitation, s’il n’est pas le loyer réel, est déduit du barème mensuel, (ex. : famille de 2 adultes, 2 enfants, aide sociale maximum $320.00 — loyer permis $105.00 — frais réels de loyer $95.00, le $320.00 est diminué de $10.00). Et l’on coiffe ça d’une publicité “aider plus, aider mieux…”
Comment une mère seule avec 3 enfants peut-elle vivre en 1974 avec $267.00 par mois, même en ajoutant $70.00 d’allocations familiales? Cela donne au total $337.00 par mois, pour couvrir tous les besoins de 4 personnes…
Comment un malade chronique hospitalisé peut-il, avec $15.00 par mois qui lui sont consentis par la loi de l’aide sociale, se payer quelques douceurs, lorsque seulement pour les services de barbier (cheveux et barbe) il lui en coûtera au minimum $10.00? Il n’a pas le droit de fumer ou de lire. Où est son droit à l’assistance? Doit-il attendre les dons, la charité?
Que fait un chef de famille (homme ou femme) qui, après une brisure de la cellule familiale, veut réunir les siens? S’il lui faut se remeubler, où prendre l’argent? S’endetter sera souvent la seule alternative.
Que fait l’individu qui pèse 375 livres lorsqu’il doit s’habiller, s’acheter des articles vestimentaires, alors que son droit à l’assistance se limite à $177.00 par mois pour tous les besoins, incluant ses frais d’habitation?
Nous pourrions ainsi multiplier les cas concrets qui, à notre avis, malgré des efforts réels de l’Etat pour soulager le sort des assistés sociaux, sont loin de réaliser dans les faits, le droit à l’assistance rappelé le 5 février 1974, lors d’une conférence de presse de l’actuel ministre des Affaires sociales qui se disait préoccupé de mettre l’accent “sur la qualité et l’humanisation des services” et qui voulait considérer les bénéficiaires de l’aide sociale, comme “des citoyens à part entière et faire en sorte que cesse toute discrimination à leur endroit”…
Quant au tribunal d’appel prévu dans la loi, il ne s’agit que d’un tribunal chargé d’analyser s’il y a eu erreur dans l’application de la loi. Aucune des situations précitées ne peut être modifiée ou améliorée par ce tribunal d’appel.
Perspectives
La notion de valeurs rattachées au travail demeure très forte dans la loi d’aide sociale. Le droit à l’assistance peut être retiré à l’individu qui refuse un emploi. Où est alors le droit à l’assistance? Est-ce que vendre son énergie à un employeur doit être une source de fierté? Un assisté social qui cultive son jardin, bricole, ou promène ses enfants, ne fait-il pas un travail aussi enrichissant? Enfin si la politique soutenue veut que l’assistance sociale soit un droit et non un privilège, il n’y a pas de honte a exercer ses droits! Pourtant pour bien conserver la dichotomie qui existe entre l’assisté social et le travailleur, l’on maintient un décalage entre le salaire minimum et le taux d’aide sociale. L’on estime présentement au Québec que l’assisté social touche en moyenne $1.79 l’heure et le travailleur au salaire minimum de $2.10 (qui sera porté à $2.30 le 1er novembre 1974).
Le revenu minimum garanti serait à notre avis une solution beaucoup plus valable que des programmes d’aide, toujours basés fondamentalement sur le principe de moindre éligibilité. Dans un rapport “Principes et hypothèses du bien-être social” (C.C.B.E.S. – Juin 1967) l’un de ces principes est ainsi formulé “Nos régimes et nos programmes sociaux doivent assurer à chaque canadien, à titre de droit, assez de revenus pour que lui-même et ceux qui sont à sa charge bénéficient au moins d’un niveau de bien-être physique et mental.” “Un revenu garanti à tous devrait être un élément d’une telle politique”, y ajoute-t-on!
Ainsi constatons-nous une évolution des mesures d’assistance sociale et des mentalités vers une garantie d’un revenu minimum à chaque citoyen. Dans cette optique, disparaît la notion d’assisté au profit de celle de citoyen dans toute son acceptation.
Nonobstant les principes qu’elle affirme, malgré une amélioration notoire, par rapport aux lois sociales (assistance publique, pensions catégorisées) antérieures, malgré les tentatives gouvernementales visant à rendre la loi plus humaine, la loi d’aide sociale donne surtout lieu à des “dons” accordés à ceux qui ne peuvent plus s’en tirer d’aucune autre façon. C’est la ressource ultime! Dans ce contexte et dans ce système, les assistés sont dépendants à la fois du gouvernement, de l’agent de bien-être, des situations et des conditions de vie qui leur sont imposées. L’humiliation demeure persistante: attitudes de la population en général, de l’entourage, parfois même de l’agent de bien-être. Il subsiste une obligation de quémander, les ressources extérieures à l’aide sociale (mobilier, literie, etc.) et les ressources accordées par l’aide sociale (à titre de besoins spéciaux: prothèses, etc.).
Voilà pourquoi nous ne croyons pas que dans les faits, la loi d’aide sociale réalise les objectifs qu’elle s’est fixés.


